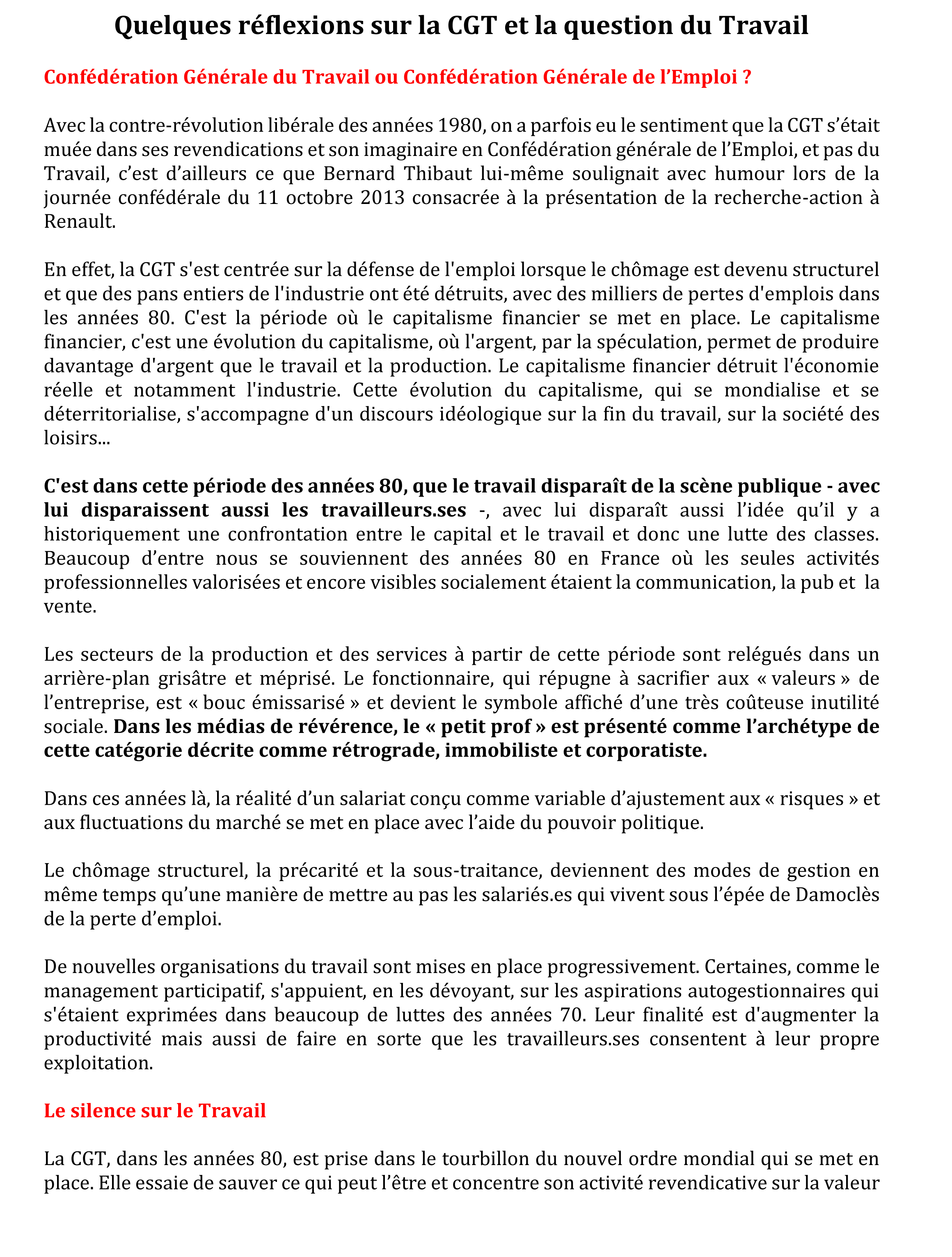Quelques réflexions sur la CGT et la question du Travail

Confédération Générale du Travail ou Confédération Générale de l’Emploi ?
Avec la contre-révolution libérale des années 1980, on a parfois eu le sentiment que la CGT s’était muée dans ses revendications et son imaginaire en Confédération générale de l’Emploi, et pas du Travail, c’est d’ailleurs ce que Bernard Thibaut lui-même soulignait avec humour lors de la journée confédérale du 11 octobre 2013 consacrée à la présentation de la recherche-action à Renault.
En effet, la CGT s’est centrée sur la défense de l’emploi lorsque le chômage est devenu structurel et que des pans entiers de l’industrie ont été détruits, avec des milliers de pertes d’emplois dans les années 80. C’est la période où le capitalisme financier se met en place. Le capitalisme financier, c’est une évolution du capitalisme, où l’argent, par la spéculation, permet de produire davantage d’argent que le travail et la production. Le capitalisme financier détruit l’économie réelle et notamment l’industrie. Cette évolution du capitalisme, qui se mondialise et se déterritorialise, s’accompagne d’un discours idéologique sur la fin du travail, sur la société des loisirs...
C’est dans cette période des années 80, que le travail disparaît de la scène publique - avec lui disparaissent aussi les travailleurs.ses -, avec lui disparaît aussi l’idée qu’il y a historiquement une confrontation entre le capital et le travail et donc une lutte des classes. Beaucoup d’entre nous se souviennent des années 80 en France où les seules activités professionnelles valorisées et encore visibles socialement étaient la communication, la pub et la vente.
Les secteurs de la production et des services à partir de cette période sont relégués dans un arrière-plan grisâtre et méprisé. Le fonctionnaire, qui répugne à sacrifier aux « valeurs » de l’entreprise, est "bouc émissarisé" et devient le symbole affiché d’une très coûteuse inutilité sociale. Dans les médias de révérence, le « petit prof » est présenté comme l’archétype de cette catégorie décrite comme rétrograde, immobiliste et corporatiste.
Dans ces années là, la réalité d’un salariat conçu comme variable d’ajustement aux « risques » et aux fluctuations du marché se met en place avec l’aide du pouvoir politique.
Le chômage structurel, la précarité et la sous-traitance, deviennent des modes de gestion en même temps qu’une manière de mettre au pas les salariés.es qui vivent sous l’épée de Damoclès de la perte d’emploi.
De nouvelles organisations du travail sont mises en place progressivement. Certaines, comme le management participatif, s’appuient, en les dévoyant, sur les aspirations autogestionnaires qui s’étaient exprimées dans beaucoup de luttes des années 70. Leur finalité est d’augmenter la productivité mais aussi de faire en sorte que les travailleurs.ses consentent à leur propre exploitation.
Le silence sur le Travail
La CGT, dans les années 80, est prise dans le tourbillon du nouvel ordre mondial qui se met en place. Elle essaie de sauver ce qui peut l’être et concentre son activité revendicative sur la valeur d’échange du travail (emplois, salaires, retraites, qualifications, statuts…) au détriment de sa valeur d’usage : la finalité, le contenu et le sens du travail, les conditions de sa réalisation.
Politiquement, la question du travail est abandonnée... notamment par le Parti Communiste, qui, pourtant, historiquement, était le Parti des travailleurs.ses.
Toute l’expérience, les cultures et les langages de métiers sont disqualifiés. Ce sont d’ailleurs les métiers même qui disparaissent : l’ouvrier devient un opérateur, l’instit professeur.e des écoles et le boucher un désosseur. Les anciens ne sont plus reconnus comme porteurs d’expérience mais comme une charge encombrante fragilisant la bonne marche de l’entreprise, du bureau ou du service. Le surtravail se met en place, éreintant la tranche des 35-45 ans tandis que le chômage de masse s’installe, frappant les jeunes et les seniors.
Ce sont toute la fierté et la dignité de la classe ouvrière qui sont fracassées. Avec elles, c’est véritablement le « pouvoir d’agir » du salariat qui est mis à mal.
Le retour du travail
Mais au début des années 2000, le travail, fait son retour sur la scène publique de manière dramatique sous forme de la souffrance au travail... avec les premiers suicides médiatisés à Renault Technocentre et à France Télécom. C’est, si on voulait parler comme Freud, le retour du refoulé. La CGT se réapproprie la question du travail mais d’abord sur son versant de la souffrance.
Des chercheurs comme Christophe Dejours et Yves Clot avaient mis en évidence, depuis plusieurs années, la centralité du travail dans la vie personnelle et sociale. Ils avaient démontré que l’engagement subjectif des travailleurs.ses dans ce qu’ils font et leur aspiration à faire un travail de qualité, qui ait du sens et qui soit fait selon les règles de métier, est une question sociale fondamentale...
La CGT retrouve progressivement, à partir du 49e congrès, cette dimension de l’émancipation du travail et par le travail. Il faut préciser que des Fédérations comme la FERC travaillaient sur cette démarche depuis des années.
Elle mène en 2012 la Recherche-action chez Renault. Cette recherche-action, tout à fait exemplaire, fait travailler syndicalistes et chercheur.ses sur une « nouvelle » démarche syndicale ancrée dans le travail réel.
La CGT redécouvre en effet la célèbre phrase d’Henri Krasucki qui disait qu’il fallait « s’intéresser d’abord au carreau cassé » plutôt que de tenir des discours généraux et théoriques aux salarié.es.
Derrière sa formulation très prosaïque, cette expression d’Henri Krasucki est fondamentale. Elle ne dit pas qu’il faut seulement s’intéresser au carreau cassé... mais que l’engagement dans un processus de transformation du travail se construit à partir de l’expérience concrète, immédiate, quotidienne, qu’on en a… Les travailleurs.ses sont en effet engagés subjectivement, de manière très intense dans le travail qui est ou devrait être un acte de création. Ils y mettent du sens, des valeurs, une représentation du monde. « Dites lui d’usiner une pièce et il fabrique un monde » nous dit le chercheur Philippe Davezies. Cet engagement dans le travail, cette aspiration est un formidable ressort pour des luttes de transformation sociale. La phrase de Krasucki révèle qu’il n’y a pas discontinuité entre l’expérience immédiate et une vision politique.
Par ailleurs, elle dit aussi qu’un discours appelant à une société plus juste n’est pas crédible, si, dans le même temps, ceux qui le tiennent se soucient peu de conditions de travail déplorables et indignes... Combien de carreaux cassés, de chariots qui grincent, de logiciels qui buggent, de situations de travail ingérables sont ignorés par le syndicalisme ?
Les camarades de la CGT qui portent ces questions, conçoivent la démarche syndicale comme ancrée dans le travail réel, tel qu’il est réalisé, dans telles ou telles conditions, pour telle ou telle finalité. Partant de là, parce que seul la/le travailleur.se connaît son travail, qu’il/elle en est « expert » cette démarche met la parole au point de départ de toute démarche syndicale.
Plutôt que d’être dans l’idée qu’il faut convaincre les travailleurs.ses de se mobiliser, de se révolter, la démarche qui vise à ouvrir des espaces de paroles sur le travail peut contribuer à créer de l’exigence sociale et du collectif par la confrontation des points de vue et des aspirations sur le travail. C’est ce qui est appelé joliment « le syndicalisme de la feuille blanche ».
Plutôt que de faire des tracts pour expliquer aux travailleurs.ses ce qu’ils savent déjà, cette forme de syndicalisme préfère s’appuyer sur leurs paroles. Parler du travail, c’est reprendre du pouvoir dessus, c’est commencer à se le réapproprier, à sortir de l’aliénation. C’est se retrouver.
Cette démarche n’est autre qu’un retour au syndicalisme « originel ».
Son présupposé, c’est que la prise de conscience, point de départ de l’engagement, est d’abord un acte personnel. Ce sont la confrontation, les échanges qui créent du collectif. Permettre le passage de l’individuel au collectif est une des finalités du syndicalisme.
Il ne faut pas nier que cette manière de concevoir le syndicalisme suscite des résistances et même des mécanismes de rejet chez des militant.es aguerris. En effet, elle remet en cause, d’une manière qui peut être déstabilisante le syndicalisme tel qu’il est pratiqué depuis les années 80 et qui repose sur la délégation de pouvoir et l’idée que le syndicaliste doit « sauver les travailleurs.ses ».
Souvent malgré eux, des syndicalistes ont en effet été aspirés dans « la sphère employeur » avec pour souci de convaincre ceux-ci qu’ils font de mauvais choix pour les travailleurs.ses.... Ils se culpabilisent de ne pas y arriver. L’absence de marges de manœuvres pour la négociation, qui est une caractéristique de la période actuelle, les met en échec, les fait souffrir, mais il est compliqué de sortir de postures et d’habitudes qui ont été posées comme la bonne façon de militer. A quoi sert, pourtant, de faire une déclaration liminaire en début de réunion, si l’employeur ou ses représentant.es ne tiennent aucunement compte de ce qui a été dit ? A quoi bon être dans tous les groupes de travail si rien n’en ressort de concret pour les travailleurs.ses ?
Les orientations votées au 51econgrès confédéral rappellent d’ailleurs l’importance d’investir les lieux de négociations et les IRP mais posent clairement le fait que le centre de gravité de l’exercice syndical est avant tout le lieu de travail.
De quoi la souffrance au travail est-elle le nom ?
Il serait déraisonnable de sous-estimer la réalité de la souffrance au travail... Les statistiques le montrent, il y a une part énorme de la population des salarié.es qui développe des pathologies du travail. La nouveauté, avec le capitalisme financier, c’est que la souffrance physique existe toujours et qu’il y a une massification de la souffrance mentale. Celle-ci touche toutes les catégories professionnelles et tous les niveaux des hiérarchies.
La CGT entend agir sur cette souffrance à travers des instances comme le CHSCT. La question de savoir si c’est suffisant reste posée… D’autant qu’il n’y a pas de CHSCT dans tous les établissements et on voit que cette instance est menacée de disparition.
On peut se poser la question de savoir pourquoi la problématique des conditions et de l’organisation du travail n’est pas davantage portée syndicalement alors qu’elle arrive avant la question des salaires dans les revendications exprimées spontanément par les salarié.es ? (tout comme il faut bien aussi le dire, l’aspiration à l’égalité Femmes-Hommes dans les lieux de travail et dans la société).
Pour la CGT, ce qui crée de la souffrance, entre autres, c’est l’impossibilité de bien faire le travail. C’est ce qu’on appelle le travail empêché qui est une des caractéristiques du capitalisme financier. La souffrance au travail n’est donc autre que l’expression de l’aspiration à travailler mieux, autrement. C’est un des aspects saillants de la lutte des classes avant même celle de la sous-rémunération du travail.
On voit bien que cela dépasse largement le cadre de l’action des élu.es en CHSCT mais que cela pose plus globalement la question de quel syndicalisme on pratique.
Quelles luttes pour changer le travail
La première des luttes, c’est sans doute celle qui viserait à ouvrir des espaces de paroles et de compréhension sur le travail... On ne fera pas l’économie de cette reprise de pouvoir, qui pour s’effectuer, doit s’inscrire dans le temps long.
Le psychanalyste Roland Gori, avec lequel l’OFCT de la FERC a travaillé sur la question de l’évaluation, dit qu’avec la (prétendue) Culture du résultat, le récit sur le travail a complètement disparu.... N’est-ce pas au syndicalisme de lui redonner une place et une fonction de socialisation ?
Pareillement, ne faut-il pas interroger la grève comme moyen d’arrêter la production ou le service ? On voit bien que c’est de plus en plus problématique pour les salarié.es de faire grève. Porter un jugement moral là-dessus ne mène à rien et ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Des raisons comme l’endettement des ménages, comme l’intoxication médiatique sont souvent avancées. Il est probable que les nouvelles organisations du travail pèsent aussi lourdement car elles ont pour point commun de rendre le/la salarié.e seul comptable de son travail. C’est ce qu’on appelle en terme pédants « l’intériorisation de la contrainte » et qui explique, pour partie, les suicides de certains salarié.es. Ceux-ci, pour en finir avec le travail, ne voient plus d’autre issue qu’en finir avec eux-mêmes.
N’est-ce pas au syndicalisme de mener un travail de déconstruction de ces pratiques managériales qui font de chaque travailleur.se son propre tyran ? On connaît des syndicats, dans la santé, dont le premier objectif est de démontrer que si les agents ne peuvent faire le travail, ce n’est pas de leur faute.
Le syndicat des agents du Conseil Départemental du Morbihan a aussi posé comme fondamental le travail collectif de décodage des pratiques managériales tant dans leurs finalités que dans leur fonctionnement et leurs effets.
La question du travail bien fait
La CGT considère que l’aspiration a bien faire son travail est potentiellement un formidable moteur de mobilisation.
On peut se demander évidemment quelle forme prend cette aspiration à faire un travail de qualité dans certains secteurs comme l’industrie de l’armement ou l’agro-alimentaire.
En fait, la question du travail bien fait peut en effet se limiter aux procédures et à la qualité. Et on peut concevoir que les travailleur.ses s’épanouissent à fignoler des ogives nucléaires ou à traiter des poulets aux antibiotiques dans les règles de l’art... Eichmann était très satisfait de répondre aux objectifs d’acheminement des Juifs vers les camps d’extermination.
Cependant, on s’aperçoit vite qu’ouvrir la réflexion sur comment on fait, pose aussi celle de pourquoi on fait et du sens du travail..., du rôle de la production ou du service pour la société qui nous entoure, du process de production et des échanges internationaux, de la matière première, des investissements, de l’emploi, des capitaux, de l’articulation avec la vie privée, des transports, de la garde des enfants, de l’égalité femmes-hommes, de la formation professionnelle, etc.
Ouvrir la réflexion sur le travail, c’est s’ouvrir sur le monde et l’interroger... C’est se situer dans l’histoire et s’approprier une culture, celle de son métier, celle du monde du travail, de sa classe... C’est, potentiellement, à partir de son histoire singulière, s’ouvrir sur l’universalité de l’Homme.
En cela, partir du travail est terriblement offensif. C’est créateur de dignité, d’exigences sociales et de fraternité... C’est potentiellement porteur d’une remise en cause radicale de notre mode de production capitaliste. Prenons le cas de quelqu’un qui est blessé et qui va aux urgences par exemple. S’il se pose comme usager – consommateur, il va fulminer contre le personnel en raison de la longueur de l’attente. S’il se pose en travailleur, il va pouvoir décoder ce qui se passe, et malgré son état, faire savoir aux personnels hospitaliers qu’il comprend, les soutient et dénonce les politiques budgétaires qui frappent l’hôpital.
Une appropriation différenciée au sein de la CGT selon les secteurs
Il y a des secteurs comme la santé où, de fait, la question du sens du travail et des moyens alloués pour le faire se pose de manière cruciale parce que le travail empêché est dangereux pour les patients. Les démarches syndicales dans les établissements partent tout naturellement de l’exercice du travail réel...
Dans certains secteurs comme la navale on voit aussi des démarches qui visent à élaborer des contre-projets industriels qui reposent sur la satisfaction des besoins sociaux, le respect de l’environnement et pas seulement sur la création d’emplois... On voit beaucoup d’expériences comme celles-là. C’est souvent l’annonce d’un PSE qui permet d’amorcer la réflexion sur ce qu’on produit, pour quoi on produit et comment.
Il y a des secteurs où l’idée même que les professionnels exercent un « travail » est problématique. C’est le cas de champs de la Fonction Publique ou de certains métiers. On citera par exemple les enseignant.es ou les médecins... Chez eux, le travail est vécu majoritairement comme une « mission ». Or cette notion, très marquée par une dimension sacrificielle, par le don de soi, par l’abnégation, est difficilement compatible avec un syndicalisme de conquête de droits. Demander l’application de droits existants est même quasiment une faute professionnelle puisque demander cela, c’est penser à soi avant les élèves, les patients...
Ce qui est frappant, dans le métier d’enseignant.e par exemple, c’est que la souffrance au travail est portée comme la preuve de l’engagement professionnel et qu’il ne faut pas y mettre un terme parce que cette souffrance est inscrite dans la culture et même l’esthétique du métier... C’est très complexe et cela ressemble aux « œillères volontaires » des travailleur.ses du bâtiment – une construction défensive très puissante qui permet aux travailleur.ses de ce secteur de continuer à travailler dans des conditions dangereuses en niant le danger et en jouant avec lui, en ne mettant pas leurs EPI par exemple.
Un ergonome comme Damien Cru, qui intervient d’ailleurs dans les formations travail santé de la FERC, montre en quoi le syndicalisme, plutôt que d’aller contre, peut faire avec ses constructions défensives, avec tout ce que les travailleur.ses ont inventé pour tenir... Les camarades du Conseil Départemental CGT du Morbihan ont organisé un colloque dont un des enjeux était d’ouvrir la parole sur ce que les agents ont inventé pour se protéger, protéger leur santé et protéger leur travail du management... L’idée est de mettre en lumière des pratiques clandestines, de les socialiser, pour faire de ces actes de création une force susceptible de remettre en cause le management en question. C’est une sorte d’aïkido syndical !
Le travail est-il forcément lié au capitalisme ?
Le travail est au centre de toute vie humaine... Il est impossible de concevoir une société dans laquelle il n’y aurait pas de travail... Si on regarde autour de nous tout est le fruit du travail des hommes et des femmes : routes, maisons, écoles, moyens de transport, nourriture, éducation, soins... Après, la manière dont ce travail est organisé, sa finalité, sont des constructions sociales qui évoluent dans l’histoire. L’esclavage est un mode de production dans lequel seuls quelques uns travaillent pour les autres et, dans le même temps, sont privés de tous droits. Le mode de production capitaliste est différent : ceux qui ont les capitaux et ceux qui sont contraints de vendre leur force de travail sont opposés dans leurs intérêts : c’est ce qu’on appelle la lutte des classes.
Cette lutte des classes oppose Capital et Travail. Cela veut dire qu’on ne peut en avoir la compréhension que si on se pose non seulement la question du Capital, de la bourse, des actionnaires, etc. mais aussi celle du travail salarié, qui n’est pas loin de l’esclavage quelquefois...
Se cantonner dans la lutte syndicale, aux questions de salaire, de retraite, d’emploi ne pose pas les questions de fond qui sont " qui travaille ? Pourquoi on travaille ? Pour qui ? Pour quels besoins ? Dans quel cadre ?". Par ailleurs, la question de la dignité, qui est au point de départ de toutes les luttes dans l’histoire, n’est plus portée syndicalement et encore moins politiquement alors qu’elle est au cœur du discours « spontané » des travailleur.ses.
Comme le montre le spécialiste en droit social, Alain Supiot, le compromis historique qui a fondé le salariat au 19esiècle est en train disparaître. Ce compromis était fondé sur : il y a ceux qui ont les capitaux et qui exploitent ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail et qui, en contrepartie de leur exploitation et de leur aliénation, bénéficient d’une certaine sécurité et de certains droits.
Avec l’Uberisation, la numérisation, accompagnées par des lois comme les Lois Travail, on arrive à une organisation nouvelle du travail qui s’appelle « le travail au robinet ». Le capital entend mettre un terme au salariat trop contraignant et met en place des organisations où le travail doit être « accessible » quand on en a besoin seulement. La notion de sécurité disparaît totalement. On va, si on ne fait rien, vers un capitalisme post-salarial.
On voit que le Capital est tout à fait capable de s’adapter, de se renouveler, de dépasser ses contradictions et que face à cela, nos grilles de lecture sont quelquefois un peu rigides et archaïques. Il faut libérer la parole, l’imagination et la pensée sur ces questions du travail qui sont, non seulement syndicales, mais aussi fondamentalement politiques. Pour cela, on ne fera pas l’économie de beaucoup de travail d’appropriation des apports d’intellectuel.les et de chercheur.ses... Il faut donc reconstruire l’idée que la Culture est émancipatrice... Cette idée était auparavant indissociable de l’histoire du mouvement ouvrier.
Parallèlement à la réflexion que la CGT mène sur le fameux coût du capital, il est important de porter la question de la « valeur DU travail », valeur qui se pose non seulement en termes de valeur d’échanges mais aussi de valeur d’usage bien sûr.
Le travail est globalement un impensé depuis plusieurs décennies mais il est en train de revenir sur la scène sociale à travers la loi étrangement baptisée par ses détracteur.trices « Loi Travail ». On peut y voir encore le retour du refoulé et le signe que le corps social veut mettre un terme au silence sur cette question et la remettre au cœur du débat démocratique.
A nous syndicalistes, travailleur.ses et citoyen.nes de prouver que c’est de bien d’autre chose dont nous voulons débattre. Les luttes contre la Loi Travail version XXL sont une occasion d’ouvrir ce chantier gigantesque mais passionnant !
Claudine Cornil
Observatoire Fédéral des Conditions de Travail de la FERC-CGT